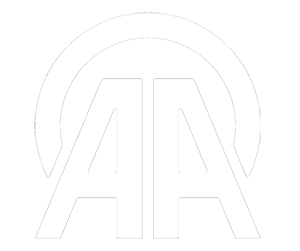Rouge, jaune, vert : Bob Marley à jamais (Portrait)
- Retour sur l’histoire saccadée du gamin issu du ghetto de Trench Town dans la capitale jamaïcaine, Kingston, devenu par la grâce du reggae, le porte-étendard des sans noms de l’histoire, pourfendeur de la Babylone corrompue, capitaliste et blanche

Tunis
AA/Tunis/Majdi Ismail
Pas assez noir, ni trop blanc, un métisse. Autant dire que la couleur de peau de Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, le prédestinait à un habitus clivé, à un devenir de transfuge de classe, à être la voix des sans voix, celle des vaincus qui résonne au cœur du pouvoir blanc.
Digne héritier de Leonard Percival Howell, fondateur du rastafarisme, disciple d’Haïlé Sélassié Ier, - empereur d’Ethiopie considéré comme la réincarnation du Christ et le rédempteur du peuple noir -, marqué par l’histoire de son compatriote jamaïcain, Marcus Garvey, maître de l’invective contre les Blancs et l’un des précurseurs du panafricanisme et de la conscience noire ayant pour mot d’ordre « l’Afrique aux Africains », Bob Marley, le « Lion de Juda », a conservé toute sa dimension iconique dans le Tiers monde, et plus encore dans le Continent noir, quarante et un ans après sa mort. Il est plus que jamais au firmament.
Par la grâce du reggae, Marley le « sudiste », incarnait l’image de la dignité outragée, parlait à ceux d’en bas, aux sans-droits, aux laissés-pour-compte, au peuple noir, du Bronx à Soweto, de Marseille à Dakar. Une véritable survivance des lucioles n’en déplaise à Pier Paolo Pasolini. La ségrégation, la lutte contre la suprématie blanche, l’émancipation et la paix, étaient au cœur de son message universel, avec en filigrane l’histoire violente de son île natale, la Jamaïque.
- Marley avant la légende
Bob Marley, né Robert Nesta Marley, le 6 février 1945 à Rhoden Hall, près de Nine Miles dans la paroisse de Saint Ann en pleine campagne dans la Jamaïque colonisée, d’une mère noire, Cedella Malcolm, Jamaïcaine, descendante d’esclaves afro-caribéens qui travaillaient dans les plantations et d’un père blanc d’origine britannique, Norval Sinclair Marley, contremaître des plantations chargé de superviser la subdivision des terres coloniales. Fruit d’une union atypique sur fond d’amour clandestin, entre une femme âgée de 18 ans et un homme impétueux et errant qui en avait 59 au moment de la naissance de son fils, Bob Marley a vécu une enfance remplie de négligence, d’ostracisme et de préjugés, notamment en raison de l’absence de son père, qui était toujours par monts et par vaux et de la précarité. « Bob était un enfant sauvage. Il devait se débrouiller pour trouver quelques plantes pour le déjeuner et dénicher lui-même à manger. Bob était un enfant qui n’obtenait pas tout ce qu’il souhaitait. Il n’avait pas droit à ce que tous les autres enfants avaient », dixit Bunny Wailer, membre fondateur du groupe The Wailers avec Bob Marley.
Adolescent, Bob quitte Nine Miles avec sa maman pour s’installer en 1957 à Trench Town, quartier des subalternes situé dans la ceinture de misère de Kingston, capitale de la Jamaïque. C’est le ghetto des délaissés de la colonisation. Un quartier insalubre construit après l’ouragan Charlie en 1951, sans eau courante, ni électricité, dépourvu de système d'évacuation des eaux usées, à la merci des incendies et des épidémies. La mortalité infantile élevée, la criminalité endémique, la pauvreté chronique, le chômage alarmant, le surpeuplement, sont les marqueurs de cette communauté-garnison caractérisée par le vote homogène assuré par le recours à la violence non institutionnelle sur cette île des Caraïbes.
« Trench Town avait le jour des airs de ville bombardée avec ses baraques de guingois, sa terre écorchée et ses restes de végétation tropicale. La nuit, éclairée ici et là par la lumière vacillante d’une lampe à huile à la fenêtre d’une bicoque, la ressemblance avec un champ de bataille hérissé de zinc, de béton et d’ordure, était encore plus frappante », écrit Rita Marley, l’épouse de Bob.
Cet « enclos à bestiaux » possède deux particularités. La première est celle d’être un vivier intarissable pour le recrutement des gangs armés des deux partis politiques rivaux en Jamaïque, le People National Party (PNP) et le Jamaica Labour Party (JLP). La deuxième c’est d’avoir enfanté les Peter Tosh, Joe Higgs, Wailing Souls, Bunny Wailer, et Bob Marley, devenant ainsi le terreau de genres musicaux comme le ska, le dub, le rocksteady, les sound systems et le reggae et de l'éclosion de nombreux musiciens de talents.
- L’homme qui a « amené le ghetto chez les gens de la haute »
À Trench Town, en dehors des armes, des magouilles politiques, et du narcotrafic, le sport et la musique servent d’ascenseur social. Bob Marley se trouve une raison de vivre dans le rastafarisme, en s’inspirant de Leonard Percival Howell, à jamais le premier dans ce culte syncrétique. Et pour cause, inventé au début des années 1930, le rastafarisme, mouvement de dissidence religieuse et de contestation sociale, avait tout pour provoquer l’ire des autorités coloniales britanniques. Il rassemble les descendants d'esclaves et clame la noblesse de la race noire. Son premier commandement on ne peut plus subversif déplait particulièrement à l'establishment : « Tu ne paieras pas d'impôts à la reine d'Angleterre ». En somme, les adeptes du rastafarisme, avec la marijuana comme sacrement, ne s’adressent plus aux Blancs les yeux baissés, à la troisième personne, mais désormais ils les apostrophent.
Marley se fait pousser des tresses folles (dreadlocks), qui lui faisaient crinière de Lion de Juda, vénère le Négus (empereur d’Ethiopie) Haïlé Sélassié Ier, nouveau messie des Noirs, adhère aux thèses de son compatriote et idéologue noir, Marcus Garvey, fondateur de l'Universal Negro Improvement Association (UNIA) la première internationale noire, - qui professe le « sionisme de la race nègre » et adopte comme slogan « l’Afrique aux Africains », -, et consomme sans modération la marijuana, « cette drogue sacrée qui permet de communiquer avec Dieu », selon ses dires. Il arbore non sans fierté, les couleurs symboles du rastafarisme, le rouge (celui du sang versé par les esclaves pour la liberté et la justice), le jaune (pour les richesses, à commencer par l’or pillé par les colons en Afrique) et le vert (signe de la végétation luxuriante, de la fertilité de la terre, mais encore de l’espoir).
La Jamaïque accède à l’indépendance en 1962. Un an plus tard, Bob Marley fonde avec Bunny Wailer et Peter Tosh, le groupe de reggae « The Wailers ». Le trio cartonne en février 1964, avec le titre « Simmer Down » qui devient numéro 1 sur l’île des Caraïbes.
En 1966, après plusieurs séjours aux États-Unis et son mariage avec Rita, Bob Marley revient en Jamaïque. Il crée son propre label « Wail’N Soul’M », sur lequel il sort différents titres dont « Bend down low », sans véritable succès. Malgré une collaboration avec Johnny Nash, - premier chanteur non-jamaïcain à enregistrer du reggae en Jamaïque -, qui le conduit en 1971 en Suède puis en Angleterre et lui permet d'enregistrer « Reggae on Broadway » en 1972, la carrière musicale de Bob Marley peine à décoller.
L’homme aux yeux plissés, au large sourire et au visage émacié en appelle à un Blanc du nom de Chris Blackwell, producteur de musique anglais, fondateur du label Island Records, avec lequel il finit par signer un contrat qui donne naissance aux albums « Catch a fire » et « Burnin » tous deux sortis en 1973 et qui le font connaître en Europe.
Bob Marley commence à tutoyer l’universel. En 1974, Éric Clapton reprend son titre « I shot the sheriff », mais surtout, il enregistre « No Woman No Cry » qui figure sur l'album Natty Dread (1974), mais c’est la version de l’album « Live! » enregistrée à Londres en 1975, qui deviendra un morceau incontournable du reggae. La carrière internationale du mulâtre est définitivement lancée en 1976 avec l’album « Rastaman vibration », de Bob Marley and The Wailers.
L’enfant du ghetto qui se faisait tabasser minot, désormais sur le toit du monde, finira par élire domicile au 56, Hope Road, là même où habitait Michael Manley, le Premier ministre de la Jamaïque. Dans cette ancienne propriété de Chris Blackwell, patron d’Island Records, l’auteur-compositeur-interprète et musicien jamaïcain, Bob Marley, assure les séances de répétitions, s’adonne au football et reçoit ses compatriotes qui demandent ses conseils ou son aide matérielle, le tout, entre deux bouffées de ganja.
Avant que l’apôtre du reggae n’y installe son QG, la « rue de l’espoir » était calme, un peu trop même, puisque imperméable aux engrenages de Trench Town, le bidonville-garnison situé à quelques encablures. À une voisine indiscrète qui voulait en apprendre davantage sur sa domiciliation à trois numéros du Premier ministre dans ce quartier de « la classe exquise » longtemps interdit aux rastas, Bob Marley rétorquait : « J’ai amené le ghetto chez les gens de la haute ».
- L’Afrique, une terre promise, conquise par Bob Marley
Que reste-t-il des trois séjours du pape du reggae sur le Continent noir? L'histoire et la mémoire. À commencer par cette photographie mnémogénique prise au pied du monument du Lion de Juda, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Au premier plan, Bob Marley vêtu aux couleurs panafricaines rouge-jaune-vert. À l’arrière-plan, posée en hauteur sur son socle, la statue du lion coiffé d’une couronne et tenant un sceptre dans sa patte avant-gauche.
Le retour en Afrique, terre promise d’où viennent ses ancêtres déportés au temps de l’esclavage, était marqué par le pèlerinage de Bob Marley en Éthiopie. Avant de fouler le sol de la terre originelle et sacrée du peuple noir en novembre 1978, le messager du reggae, aux plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde, a dû attendre quelques jours à Nairobi au Kenya avant d’obtenir un visa pour l’Éthiopie. Lui qui avait reçu, quatre mois auparavant, des mains de l’ambassadeur sénégalais à New York la médaille de la paix des Nations unies « au nom de 500 millions d’Africains ».
Il faut dire que le gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste, d’obédience soviétique, qui avait renversé le « Roi des rois » en 1974 avant de l’assassiner en 1975, ne voyait pas d’un bon œil la venue de l’artiste jamaïcain. Le texte de « War », titre phare interprété par Bob Marley n’est autre que la reprise, mot pour mot, du discours de l’empereur Haïlé Sélassié Ier, prononcé à la tribune des Nations unies, en 1963 : « En attendant que la philosophie qui tient une race supérieure et une autre inférieure ne soit, enfin et définitivement, discréditée et abandonnée, partout, c'est la guerre. Je dis : guerre. Et tant qu'il y aura des citoyens de première et de deuxième classe, dans chaque nation, tant que la couleur de peau d'un homme n'aura pas plus de signification que la couleur de ses yeux, je dis : guerre ! ».
C’est également durant ce séjour qu’il commence à composer son opus « Zimbabwe », hymne à l'indépendance de la Rhodésie, qui était sous la férule du pouvoir blanc ségrégationniste.
Bob Marley et son groupe de musiciens se rendront début janvier 1979 à Libreville au Gabon à l’invitation de Pascaline Bongo, fille du Président Omar Bongo, à la tête de cet État d’Afrique centrale depuis 1967 (jusqu’en 2009).
Le paradoxe entre une musique prônant l’égalité et le régime de Bongo qui faisait peu de cas de cette valeur des droits de l’homme et peu enclin à la démocratie, avait entamé le crédit de l’artiste engagé, qui ne cessait d’inciter les opprimés à se battre pour leurs droits à travers les paroles de son autre opus « Get Up, Stand Up ».
Après la tribulation gabonaise, Bob Marley and The Wailers, sont invités à se produire dans le stade Rufaro à Salisbury (rebaptisé Harare en 1982) en avril 1980 dans le cadre des cérémonies d’indépendance du Zimbabwe. Le morceau du même nom (Zimbabwe), repris par les guérilleros noirs communistes combattant le gouvernement de Rhodésie du Sud durant la guerre du Bush, sonnait déjà comme une prémonition pour la victoire des insurgés contre la minorité blanche, alors au pouvoir.
Ayant échappé une fois à la mort, à la suite d’une tentative d’assassinat éminemment politique le 3 décembre 1976 dans son sanctuaire de Hope Road, Bob Marley sera fauché en pleine ascension par son mélanome, un cancer de la peau. Défiguré par la chimiothérapie, considéré comme perdu, celui qui résista tout au long de sa vie à toutes les adversités, sera rapatrié à Miami, dans la maison de sa mère, où il va s’éteindre le 11 mai 1981, à l’âge de 36 ans. L’homme est mort, la légende est née.
Seulement une partie des dépêches, que l'Agence Anadolu diffuse à ses abonnés via le Système de Diffusion interne (HAS), est diffusée sur le site de l'AA, de manière résumée. Contactez-nous s'il vous plaît pour vous abonner.